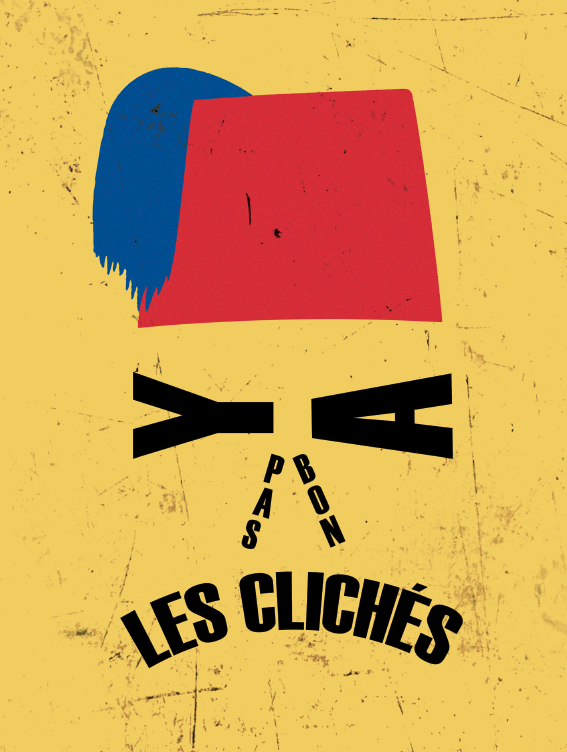LA TABLE RONDE

La table ronde s’est ouverte avec la projection d’un extrait du film documentaire de Samir Abdallah, « Candidat pour du Beurs », produit par France Ô mais jamais diffusé… Les premières images donnent le ton : dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, on débat en off sur les questions d’immigration et d’identité nationale. On y dort, on s’indigne, on y siffle, on y rit, tandis que défilent devant nous les symboles de la République, ses maîtres penseurs, ses représentations, ses gardiens. L’auteur a suivi durant les élections de 2007 à 2009, le parcours de jeunes candidats issus de l’immigration, espérant que l’un deux franchirait les grilles de l’Assemblée pour rejoindre le cercle des parlementaires. Il n’en fut rien.
Pour Samir Abdallah, l’histoire de son cinéma est indissociable du militantisme. Samir a grandi en Egypte. Jeune, il vit en France avec l’idée qu’il est en transit et qu’il retournera en Egypte faire la Révolution… Cette idée, c’est son père qui lui transmet. Peintre, exilé politique, son père l’entretient avec cet impératif contradictoire : « Ici tu te tais, c’est là- bas que cela se passe ». Là-bas, Samir rencontre des réalisateurs égyptiens, mais l’engagement politique, c’est ici qu’il va le prendre. En 1982, alors qu’il prépare le concours de l’IDHEC (école de cinéma), son ami Abdenbi Guémia meurt assassiné.
Ce jeune homme de la Cité Gutenberg à Nanterre est victime d’un crime raciste. Samir déjà impliqué dans la lutte pour les droits des immigrés, se mobilise au sein du Comité Gutenberg crée autour de cette tragédie. Le comité oeuvre pour le relogement des familles. Très vite, Samir et les militants se posent la question de l’image renvoyée par les médias. « Et pourquoi ne pas être maître de notre image ? » « Et pourquoi pas les faire nous mêmes ces images et les diffuser ».
C’est ainsi que Mogniss, son frère, crée l’agence IM’média. Abdennbi était un ami très proche, et Samir a ressenti très fortement le besoin de raconter l’histoire de celles et ceux qui ont mené des luttes. Faire des films c’était une façon de participer à la lutte, faire la chronique de Gutenberg était un acte militant.
Et l’Egypte dans tout ça ? L’Egypte a longtemps été un pays idéalisé, et en même temps compliqué, interdit de séjour, y retourner signifiait faire son service militaire ou faire un séjour en prison. Mais, en janvier 2010, Samir était un des premiers, à filmer Place Tahrir, la liberté de parole des Égyptiens…
De Voyage au pays de la Peuge, en passant par la Ballade des sans-papiers et Gaza-strophe, tout au long de sa carrière de réalisateur, Samir s’est toujours inscrit dans l’histoire des luttes pour les droits des immigrés. Son cinéma et son militantisme, il les a portés bien au delà de nos frontières.
« Assigné à résistance ». Hocine Ben, une allure, une gouaille, une casquette, une posture reconnaissables, pour le slameur du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. Lui se définit comme un échangeur de la parole poétique. Le slam, n’est rien d’autre que cette simple « escroquerie » dit-il. Hocine est un conteur urbain. Il en est venu aux mots, par amour… De ceux « soufflés » à son oreille par sa mère, de ceux déclamés par son oncle dont il reprend la parole et arbore la même casquette… Des contes maternels, il retient un personnage féminin, une sorte de super-héroïne qui repousse l’ennemi et finit toujours par tirer d’affaire le village menacé. Les parents de Hocine viennent de l’est de l’Algérie et sont arrivés en France en pleine guerre d’Algérie. Hocine reçoit donc les histoires, les chants transmis par sa mère comme un acte de résistance. Il fait sien cet engagement et devient « un assigné à résistance ».

« Ils ne m’auront pas ». En remontant le temps, il se souvient de son premier acte de résistance à lui, de la promesse qu’il s’est faite « de ne pas tomber dans le piège qui lui est tendu ». Issu d’une fratrie de 9 enfants, il quitte l’école jeune. « Authentique Bac moins 3 », après avoir quelque temps erré dans la cité, il se jure qu’il ne collera pas au chemin tout tracé de la délinquance. Il sait que seuls la culture, le savoir lui donneront cette liberté. Pour échapper à ce programme, il s’en est préparé un autre et celui là est salutaire : lire. Tout. Apprendre. Tout. D’abord apprendre sur soi. C’est ainsi qu’il dévore des ouvrages d’histoire sur la guerre d’indépendance Algérienne, découvre l’histoire de ses parents et entre autres, ce qu’il nomme un secret bien gardé : la marche du 17 octobre 1961. Il comprend beaucoup de choses et surtout le traumatisme de ses parents arrivés en France entre 1958 et 1961. Il comprend la frayeur de sa mère, devant le facteur en uniforme, l’angoisse qui la prenait quand elle lui lançait « ne vas pas à Paris, y a la police ».
Ambassadeur du 93. Hocine se sent comme un funambule. Une histoire réappropriée et un poids, celui de la colère. Son deuxième acte de résistance : ne pas être prisonnier du ressentiment. Aujourd’hui, dans son art, chroniqueur de sa ville, Hocine se sent avant tout un Icicien, un mec d’ici, d’Aubervilliers, et se présente comme un ambassadeur du 93. Passé du Hip Hop au Slam, il a gardé l’écriture. Désormais sa poésie circule partout en France, son pays, en Algérie, son bled et même jusqu’au Brésil. Hocine est devenu un authentique Bled runner : elle court, elle court sa poésie.
« J’écris tel que je suis ». Mabrouck Rachedi, n’est pas venu à l’écriture en se posant des questions « identitaires ». Son premier coup de foudre est une rencontre littéraire avec le Père Goriot, d’Honoré de Balzac. Si cette première approche, est très école républicaine, le Mabrouck adolescent consigne dans ses cahiers des écrits qui eux, tels un premier cri sont empreints de la passion de celui qui ressent une profonde injustice. Nous sommes au début des années 90.
Ce dont Mabrouck Rachedi prend conscience, c’est de la différence sociale. Ils sont 11 enfants à grandir à Vigneux-sur-Seine, dans l’Essonne. « Ca oui c’était criant qu’on était moins riche que les autres ». Ces écrits donneront naissance à son premier roman Le poids d’une âme, publié en 2006 aux éditions Jean-Claude Lattès et prix du premier roman aux Festivals de Laval et Chambéry.
C’est l’histoire de Lounès, un jeune homme de banlieue, assurément poisseux, qui dès qu’il met le nez dehors, est accablé par une série d’événements funestes qui bien malgré lui, le mèneront derrière les barreaux d’une prison. Dans ce chemin et dans un contexte de violences urbaines, Lounès fera d’heureuses rencontres, salvatrices. Son deuxième roman, Le Petit Malik, chronique d’une vie ordinaire en banlieue, parle avec plus de légèreté d’un parcours de jeunesse, d’une bande de copains. Si l’approche est davantage universaliste, elle est nourrie de son expérience personnelle, où la question identitaire est secondaire.
Et la mémoire, dans tout cela ? En 2012, Mabrouck Rachedi est invité à collaborer à l’écriture du livre Algérie 50, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Il écrit une nouvelle, Tahar. Tahar, c’est l’histoire de son frère, mort pendant la guerre d’indépendance en Algérie. Mabrouck est surpris de sa propre réaction, de ce que cette écriture remue, d’une mort difficile à accepter, d’une révolution pleine de contradictions. La mémoire, revient de plus en plus, de façon insidieuse…
Et pour l’heure, la littérature reste avant tout un moyen de sortir de son histoire, de voyager, de partir dans le monde. L’écriture, qu’il enseigne au travers d’ateliers menés avec des scolaires, quant à elle est « une arme d’expression massive » ou de transmission massive, c’est selon. Et l’ailleurs ? Mabrouck travaille à l’écriture d’un film de fiction, une histoire d’amour…
Remembeur remercie tous celles et ceux qui ont participé à la table ronde, Naïma Yahi, Samir Abdallah, Marbrouck Rachedi et Hocine Ben. Nous remercions également le Centre Fleury Barbara, ainsi que la Mairie de Paris et Claudine Bouygues, Adjointe au Maire de Paris, en charge des Droits de l’Homme, de l’Intégration, de la lutte contre les Discriminations d’avoir accueilli et soutenu Remembeur.